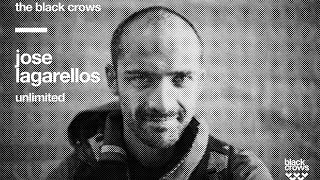Great Himal Race, trail sur les Chemins du Ciel
Depuis 1987, et son premier trek au Népal, Bruno Poirier voyage dans l’Himalaya en courant… A ce jour, il cumule 16.000 km sur les Chemins du Ciel, 1.000.000 m d’ascension céleste et de descente infernale. En 1994, il avait traversé le « Continent Montagne » népalais, en compagnie de Paul-Eric Bonneau, avec comme passeport, l’Aventure. Au printemps 2017, c’est en mode trail-running, qu’il a retraversé le Pays où les Chevaux du Vent n’achèvent jamais leur Course… Pour son 25e voyage au Népal, il était l’un des 35 coureurs qui ont disputé le Great Himal Race, l’édition unique de « La course que l’on peut voir de la Lune… » Entretien avec un homme qui aime courir le ciel, en quête d’illumination physique, à des altitudes où, paradoxalement, il y a plus d’étoiles que de ciel…
Recueilli par Mathieu COUREAU.
Photos : Virginie Duterme, Bruno Ringeval et Bruno Poirier.
1.609 kilomètres. La traversée de l’Himalaya népalais. Près de 90.000 m en positif. L’équivalent de dix ascensions de l’Everest. Vous diriez que c’est un voyage plus qu’une course ?
Voyage, course, mais aussi, compétition, expédition, exploration, le Great Himal Race fut un tout, mais surtout un voyage en solidaire. Car si l’effort était souvent solitaire, sans une certaine solidarité entre les participants, je ne crois pas qu’il y aurait eu onze coureurs (ils étaient trente-cinq au départ du Kanchenjunga Base Camp, ndlr) à réussir l’intégralité du parcours jusqu’à Hilsa. C’était une course par étapes (45) et par endroits, il y a eu des choix à faire. Si les étapes étaient prédéfinies pour des raisons de sécurité, certains ont fait un peu plus ou un peu moins de kilomètres. Faire ou ne pas faire. On ne voulait pas quelque chose de trop scolaire. On a parfois navigué pendant dix jours en trois groupes, puis on se retrouvait pendant une journée. Entre les cartes et la réalité du terrain, il y a eu beaucoup de surprises… La navigation fut compliquée par endroits. Dans ce déplacement à travers l’Himalaya, le briefing journalier était simple : « Il faut avancer dans la carte… »

Votre esprit a-t-il vagabondé, s’est-il replongé malgré vous dans ces vingt dernières années ?
Forcément, oui. Entre 1994 et 2017, l’approche de l’aventure a changé. Le pays a évolué. Le parcours, aussi. En 1994, on parcourait la moyenne montagne. On ne pouvait pas aller là-haut, en cause les autorisations au sein d’un pays alors très militarisé. En 1994, on l’a fait à deux, sans parcours établi. On avançait avec notre carte. Parfois, on n’en avait plus, alors on suivait les rivières. On allait de village en village, on se dirigeait grâce à la population locale. On était dans le quotidien des Népalais parce qu’ils étaient notre quotidien. Cette année, on avait les GPS, une balise pour que les gens puissent nous suivre, équipés comme les navigateurs du Vendée Globe. Même si on était trente-cinq au départ (onze à l’arrivée), j’ai vécu ce Great Himal Race comme une aventure en solitaire. Finalement, chacun allait à son rythme, retrouvait des gens sur la route le soir.
Une aventure en solitaire ?
La journée, oui. Il m’arrivait de partir le matin, de rattraper trois coureurs, de passer neuf heures seul dans ma journée sur dix heures d’effort. En 1994 avec Paul (Paul-Éric Bonneau), on avait fait le choix d’avancer en duo, parfois un peu seuls car on en avait besoin. En 2017, le choix se faisait presque naturellement par rapport aux qualités physiques de chacun, et par rapport à ce que chacun voulait mettre dans son voyage. Tout à l’heure, vous parliez de voyage… Que ce soit l’épreuve de 1994 ou celle de 2017, ça reste un voyage, bien sûr. Ce n’est pas parce qu’on a un dossard sur le ventre que ce n’est pas un voyage. D’ailleurs, à un moment donné, tout le monde avait enlevé son dossard. Il était sur le sac à dos car obligatoire, tout de même, pour passer les points de contrôle avec la police ou les militaires. On les a remis à la fin, parce qu’il fallait courir, arriver, pour le fun, parce que la notion de compétition est à nouveau apparue.

Une certaine solitude, donc, mais une solidarité sans faille.
Oui, une notion importante, car je ne sais pas si nous aurions pu terminer à onze. Je pense notamment à mon amie Virginie (Duterme)… Sans soutien, tout le monde ne serait pas allé au bout. Il fallait accompagner les gens dans la difficulté. Sur cette grande traversée du Haut Himalaya, l’assistance était réduite à sa plus simple expression : un guide serre-fil et huit ravitaillements personnels. Pour le reste les concurrents étaient en autonomie et devaient se débrouiller avec population népalaise. Celle-ci a donc joué un rôle important dans le succès de la course. Virginie l’a très bien résumé : « Lorsque nous étions perdu, en retard sur les autres, il nous arrivait de dormir chez l’habitant, alors que nous portions notre tente. C’était une sécurité. Des paysans nous donnaient du riz et un lit, un endroit pour dormir. Nous rentrions dans leur quotidien. Nous leur donnions de l’argent, même s’ils ne le demandaient pas toujours. »
Qui sont ces 35 coureurs ? Des égarés de la course à pied, des jusqu’au-boutistes ? Les mêmes qu’il y a vingt-trois ans ? Des gens en quête d’autre chose, de quoi ?
Plusieurs profils, plusieurs univers différents réunis… La course à pied bien sûr, l’alpinisme, des aventuriers purs et durs, aussi, qui en fin de compte profitaient de l’organisation mise en place pour vivre une aventure un peu plus sécurisée. On partait pour traverser l’Himalaya en serrant au plus près la chaîne himalayenne, voir des yeux tous les 8000m… Il y avait d’autres chemins possibles, car on peut tout à fait traverser le Népal, par les plaines du Teraï, à 100m d’altitude. Mais nous, on voulait quelque chose de grand. On était tout petit, mais on a vécu quelque chose de grand. À l’arrivée à Hilsa, village frontalier avec le Tibet, on était dix-sept, dont onze qui avaient fait l’intégralité du parcours à pied. Les autres, blessés ou malades avaient pris des véhicules. Dix-sept aventuriers, donc.

La notion d’aventuriers est complexe à définir dans nos civilisations modernes. Qui sont les aventuriers aujourd’hui ? Mike Horn, les candidats de Koh Lanta…
(Rires) Oui, oui… J’aime beaucoup cette phrase de Philippe Frey : « L’aventure, c’est prendre le risque de mettre sa vie en jeu ». On n’est d’accord ou pas. Mettre sa vie en jeu, c’est s’engager au-delà de la signature d’un papier ou d’une fiche d’inscription. S’engager, c’est s’engager physiquement, mentalement, spirituellement. Hendra (Wijaya) était de confession musulmane. Pendant le Great Himal Race, il priait tous les jours. Il priait pour terminer la course. Jung (Chumphol Krootkaew), très mal au bout de 35 jours, m’a dit : « Bruno, je vais vous laisser partir. Mais je veux finir cette course. Partez devant. » Il a fini deux jours après nous. Plutôt que de faire comme certains qui prenaient un véhicule pour rester au contact d’un groupe, il a préféré rester dans l’esprit de cette aventure. Voilà le sens pour moi de la notion d’aventure. Des gens ont mis leur vie en danger. On ne le refera, d’ailleurs pas. On sait qu’on a eu beaucoup de chance. Deux ou trois concurrents auraient pu mourir. L’un d’entre eux n’a pas fini. Il a su baisser le curseur.
Mourir de quoi ?
D’une chute, d’une pierre qui tombe, d’un sentier qui s’effondre… Parfois, il a fallu faire un pas dans le vide…. Il y a aussi le mal des montagnes, de l’altitude, généré par le phénomène d’hypoxie (la raréfaction de l’oxygène). Mais le problème majeur, ce sont les chutes. Il y a un cercle vicieux : la fatigue, le manque de nourriture par moments… On mangeait parfois ce qu’on trouvait. On avait huit ravitaillements organisés sur le parcours, de 3 à 5 kg tous les cinq ou six jours en plus de vêtements ou de chaussures. Mais parfois, à la fin de chaque section, on n’avait plus de nourriture. On pouvait manger chez l’habitant, dans des refuges, ça pouvait être facile. Parfois non. Juste une purée verte dans une cabane au fond d’une montagne. Un morceau de fromage farineux. Un verre de lait douteux. Deux concurrents ont d’ailleurs dû renoncer à cause d’une intoxication alimentaire. Voir les coureurs abandonner, c’était terrible… Il m’arrivait de me demander qui pouvait être le prochain, pensant que cela pouvait être moi…

En 2010, lors de Himal Race entre le Mont Kailash et les Annapurnas, vous aviez confié : « On ne courait plus pour rêver, on courait pour crever. J’ai alors mesuré la démesure. Je me suis senti responsable. » Et vous aviez décidé, en 2013, d’alléger le programme. 2017 était néanmoins très éprouvant…
Oui, mais avec, en 2017, les moyens nécessaires pour appréhender tout cela. À travers la sélection des coureurs d’une part, ensuite avec un esprit de solidarité inhérent à cette aventure. J’ai accepté d’accompagner des gens pour les aider, finir avec eux. En 2010, j’étais beaucoup plus dans la compétition. Et puis, toujours en 2010, des amis très proches étaient avec moi. Je les ai vus souffrir… dans un truc qui n’était clairement plus « Marche et rêve », mais « Marche ou crève », comme l’avait résumé Bruno (Ringeval). Himal Race 2010 était plus court (840 km), mais plus dur, plus engagé, avec moins d’étapes (20), mais des étapes plus longues. Le Tibet nous avait beaucoup marqué physiquement. On avait commencé à courir à 4300m d’altitude. On était resté cinq étapes de rang entre 4300 et 5800m. Les organismes étaient fatigués. Beaucoup de gens avaient renoncés une fois arrivé au Népal. Bruno, l’un des amis dont j’ai parlé, était présent cette année sur la Great Himal Race. Je savais qu’il souffrait. Sur certaines étapes, je suis resté avec lui, cette fois. On a eu beaucoup de chance…
Vous répétez : « On a eu beaucoup de chance ».
Oui. Certains chutaient, tombaient. Certains étaient dans un tel état qu’ils ne pouvaient plus avancer, prenaient des médicaments, non pas pour aller plus vite, mais pour ne plus avoir mal. Ils pouvaient communiquer avec le médecin à l’arrière via leurs GPS. Il y a eu des moments terrifiants, vraiment, je pèse mes mots. Notamment dans l’ascension du Tashi Lapsa (5755 m) et du Lauribina Pass (4610 m), où sans la réactivité de Virginie, j’aurai fait une hypothermie. Wouter (Hamelinck) et Rob (Curran) ont été les seuls à traverser le Haut Dolpo, sur un itinéraire montagne engagé au départ de Shey Gompa avec un enchaînement de cols à plus de 5000 m, où il fallait être encordé et armé d’un piolet. Ils étaient qu’en basket ! Pour traverser le Tashi, il a fallu mettre les crampons, c’était une expédition. Lorsque je vois des images de gens qui ont dormi sur le glacier (Hendra, Bruno, Anise Fontaine…) Upendra (Sunuwar), qui lors de la 14e étape, tombe dans une crevasse, se retient avec les mains et termine toute la course avec une épaule abîmée, portant son sac grâce à une corde sur sa tête… Philippe (Armbruster) qui chute dans le Tashi et ne bouge plus… C’était terrifiant. Même un simple sentier pouvait devenir terrible au détour d’un virage… Philippe qui n’avait plus que la peau et les os, une planche anatomique, qui ne pouvait plus. Il est pourtant engagé pour 2020… Il est revenu vivant, voilà sa victoire. Elle est là l’aventure. Dans la difficulté, le doute, l’échec, la souffrance, le soulagement.

Cette souffrance, même « encadrée », est-elle acceptable ? Pourquoi aller si loin ?
Vous touchez quelque chose de fondamental en ce qui me concerne, quand on parle de l’effort. J’aime beaucoup Nietzsche. Il a dit : « Seule la grande douleur libère vraiment l’esprit, car elle nous enseigne le grand doute… J’ignore si une telle douleur nous « améliore », mais je sais qu’elle nous rend plus profond ». En somme, dans la souffrance, on va chercher quelque chose qui dépasse le cadre. On recherche un petit supplément d’âme. Beaucoup de gens parlent du phénomène de lâcher-prise dans l’effort, un terme bouddhiste. Le lâcher-prise peut conduire à l’illumination. Les bouddhistes l’atteignent en étant des ascètes, grâce à la méditation et la solitude. Moi, il m’est arrivé de l’atteindre dans l’effort physique. C’est ce que je recherche. C’est bête à dire, mais c’est ce que j’aimerais que les gens trouvent. Je suis à la fois responsable de leur souffrance, mais aussi de leur bonheur quand ils arrivent là-bas, quand ils franchissent la ligne.
Tout le monde peut faire la Great Himal Race avec un guide, une tente, un porteur et 80 jours devant lui. On était libre, tout de même, et en sécurité. Un jour, je me suis perdu dans la montagne. Nous étions un petit groupe avec Bruno, qui était blessé, Damien (Manceau), Virginie, Jean-Marc (Wojcik), Bhim (Gurung), Mané (Gurung), Chhechi (Sherpa)… Au pied d’un col, je leur dis que je pars devant pour trouver un village au plus vite. Il commence à faire noir, je vois que je ne suis plus dans la bonne direction. Je retrouve mon chemin. Au loin, un village. Mais des torrents, des falaises, une forêt. Je reviens sur mes pas. Je me suis perdu encore. Des carcasses au sol. Je m’arrête et je monte ma tente. Je prépare mon réchaud, mon repas lyophilisé, je préfère attendre le matin pour retrouver le chemin, car la balise satellite ne capte plus le signal… Au Népal, deux choses ne bougent pas sur une carte : les rivières et les montagnes. La nuit, tu ne vois plus les montagnes et les rivières sont parfois infranchissables autrement que par des ponts. Donc, tu ne passes pas. Au lever du jour, je me suis aperçu que j’avais installé ma tente sur le chemin. J’étais sur le bon sentier ! 40 minutes de marche et le village était juste là. J’y ai retrouvé mes compagnons de voyage qui avaient bien dormi, bien mangé… Tout ça pour dire, que tu es parfois sur le bon chemin, mais que tu ne le vois pas. Que parfois c’est lui qui te conduit. Se perdre en chemin ou perdre le chemin ? Parfois tu perds le chemin, parfois c’est le chemin qui te perd (sourire)… Là, tu touches à l’aventure. Mais tu la maîtrises parce que tu sais qu’il va faire jour le lendemain, que tu as à manger.
Vous la maîtrisez, certes, mais votre curseur n’est pas le même que le coureur du dimanche.
Bien sûr et il a été à 8 sur 10 sans doute pendant ce Great Himal Race… (Silence)… Plusieurs concurrents ont donné des interviews dans des journaux locaux à leur retour. Les journalistes y parlaient de dépassement de soi… Une bonne fois pour toutes : tu ne peux pas dépasser tes limites. Tu peux les découvrir, les repousser, les toucher, les explorer. Mais si tu les dépasses, tu meurs. Le dépassement de soi n’existe pas dans le sport.

Vous pourriez mettre des mots sur l’illumination physique dont vous parliez tout à l’heure ?
Ça m’est arrivé deux ou trois fois au Népal. Au départ, je pensais que ça pouvait être des hallucinations. J’en ai vécues, une terrible notamment sur l’Ultra Trail du Mont Blanc. Je montais des escaliers en pierre. Et je commençais à voir derrière moi plein de lumières. Les lumières ont alors disparu pour laisser place à un grand trou noir qui avançait derrière moi. Je croyais disparaître dans ce trou noir. Je me suis mis à avancer à quatre pattes, de plus en plus vite, sur les pierres, comme un animal. Quand je posais la main ou un pied sur une pierre, elle se dérobait et disparaissait dans le trou noir. À un moment, je me suis arrêté. Un quart d’heure. J’ai dormi. Et je suis reparti.
Tout en étant conscient de votre état à ce moment ?
Au moment où tu t’arrêtes, tu fais le point sur toi-même. Tu reviens à la réalité. Les hallucinations, finalement, t’accaparent puis s’en vont. Elles ont joué leur rôle, t’ont fait croire en un scénario qui n’existe pas, ont été à la fois un théâtre et un compagnon. D’autres voient des animaux dans les arbres, parlent à des gens invisibles…

Quel est le chemin pour encaisser ou accepter que cela puisse faire partie du processus ?
C’est très personnel. Je n’ai pas la réponse… Mais le cheminement est émotionnel, car il est question de l’âme, de sa beauté. De son supplément qui fait sa profondeur.
L’illumination, c’est très différent, donc.
L’illumination physique, c’est entrer dans un état second où tout devient facile. Tu es quasiment en lévitation. Les choses avancent toutes seules. Je l’ai vécu sur un autre UTMB en fait, pas qu’au Népal. Un groupe de coureurs était devant moi. Et je me suis mis à aller très vite. Je les ai dépassés. Je n’ai pas pu leur parler. J’étais dans le lâcher-prise complet, débarrassé probablement de tout ce qui me ralentissait, la fatigue, les soucis. Je me suis mis à avancer tout seul, comme si tu te détachais de toi-même. La pesanteur n’existe plus. Tu es en apesanteur. Tu cours en méditation, presque. Ça a duré une quinzaine de kilomètres. Les coureurs dépassés m’ont récupéré juste avant l’arrivée. J’étais assis là, sur un rocher. Ils ont franchi la ligne cinq minutes avant moi. Je voulais arriver tout seul, rester seul avec ce moment.

Ce n’était pas votre première illumination physique ?
Non, j’avais vécu un truc au Tour de l’Annapurna, déjà, en 1994, avec Paul-Éric. On était un peu séparés à ce moment parce qu’il vivait mal l’altitude. J’étais devant lui, on devait se retrouver le soir dans un petit village, Upper Pisang, mon village préféré – j’aimerais qu’on y jette mes cendres -. Je savais avant même de l’atteindre, que j’allais me poser, assis, à côté du monastère, en regardant les nuages partir en fumée dans l’Himalaya. Je savais déjà ce que j’allais vivre. J’étais impatient. Là, j’étais un voyageur immobile, dans mon illumination. J’avançais comme les nuages qui venaient se déchirer sur les montagnes et qui laissaient quelques filaments derrière eux. Ces filaments étaient comme mes pensées… Je pense souvent à Pierre (Zickler), que j’ai rencontré au Népal. C’est le père spirituel de la Mandala, une course que nous organisons autour des Annapurnas. Lors de sa première participation, en 2000, il m’avait confié ceci : « Au Népal, j’ai trouvé ce que j’étais venu chercher… Cette course est grandiose, car au-delà de la dimension physique, elle possède une dimension humaine qui engendre la réflexion. Cette course a une âme et il faut la préserver. » Quand Pierre parlait de choses et d’autres, il lui arrivait de ne pas finir ses phrases. Il préférait laisser ses mains se décoller de ses tempes et les faire voler comme des papillons. Il fallait imaginer la suite, se l’approprier, se l’inventer. Je me nourris souvent de cela, de ce geste, de Pierre, de cette main qui part. Il est en fin de vie, Pierre. Il me restera toujours ça de lui et tellement d’autres choses (en larmes)…
Ces illuminations sont devenues une quête.
Oui. Justement, durant ce Great Himal Race, des gens n’ont pas compris cela. Je trouvais ça moche pour eux. D’autres, en revanche, ne sont pas allés au bout. Comme Bruno, me confiant cela : « Ce chemin est un bonheur et je veux qu’il reste un bonheur. Donc je préfère arrêter là, à cet endroit. » C’était parfait. Sur les onze qui sont allés au bout, il y avait cinq Népalais. Tu n’imagines pas leur fierté d’avoir traversé leur pays. Un pays qu’ils arpentent pourtant sans cesse à travers leur métier de guide mais qu’ils ont (re)découvert. Le vrai Népal, avec de vrais Népalais. Ils ont retrouvé leur identité, celle des gens reclus dans la montagne. On ne consomme pas un pays, nous, on le découvre. J’étais très fier de les voir heureux. Lors de la remise des récompenses, Jung qui était accompagné de Ngawang (Dawa Sherpa) pendant toute la course, a dit une très belle chose. Il a dit : « Je remercie votre pays. Et cet homme, ici à mes côtés, ce frère que je n’ai jamais eu. » Ça m’a bouleversé. Eux avaient compris le sens de cette aventure.

D’autres, donc, n’ont pas compris le sens, la quête.
Comme le disait Yves Détry, un guide de Chamonix, lorsqu’il revenait d’une ascension d’un sommet à 8000 m : « Une victoire, ça se gagne au camp de base, pas au sommet ». Beaucoup de gens ont gravi des sommets, ont fait des choses belles. Mais ils sont morts entre 8000 et 8500m. Quand tu fais l’Everest, les 1500 derniers mètres sont jonchés de cadavres qui balisent ton chemin pour monter. Ils sont morts en y allant ou en y revenant. Ils sont congelés. Tu vois des mains, des bouts de visages. Le glacier libère ses cadavres.
Ils n’ont pas compris quoi ?
Ils n’ont pas compris où on voulait les emmener. Par moments, on était quinze coureurs dans un groupe, dont cinq Népalais. Quelqu’un disait : « On est dix ». Tous n’ont pas saisi ce qui aurait pu leur permettre de revenir différents. En marche d’acclimatation, pendant six jours, je disais à certains « Pensez à là où vous allez, oubliez d’où vous venez ». En écho à cette citation de Nietzsche. « Deviens ce que tu es ! » Encore fallait-il oublier celui que l’on était, avant de partir.

Réussir ce voyage, cela consisterait en quoi ?
(Long silence)… Hendra est un alpiniste indonésien. Il a fait le GHR parce que, pour lui, c’est la course ultime. Quinze jours après être rentré, il me disait qu’il se réveillait la nuit, qu’il cherchait son sac, que c’était l’heure de partir. La course était toujours en lui. Il avait terminé, mais pour lui ce n’était pas fini. Après Hilsa, Wouter a continué sa course, il est parti faire un tour dans les vallées environnantes. Quand je suis arrivé sur le pont, juste avant la ligne, on courait en rigolant comme des gamins, une joie immense. On a sprinté alors que les classements étaient figés. C’était juste histoire de courir sur le pont. Le fou-rire a commencé avant le pont. Le Tibet 100 mètres après, avec les militaires. J’ai accroché mon dossard sur le pont en me disant que je mettrai très longtemps, avant d’en épingler un autre. A mon retour en France, trois mois après, j’en ai mis un pour l’UTMB, mais mon corps, déjà blessé, a dit stop. Depuis, j’enchaine les blessures… Il était trop tôt, pour moi… Pour d’autres, traverser le Pont d’Hilsa, était un soulagement, agenouillés sur le pont. Comme Virginie qui voulait revivre ce moment, celui de 2010. Comme Damien, pour qui c’était la première grande aventure. Il a poussé un cri en courant sur le pont. Je l’ai encore en tête… J’avais terminé ce voyage en étant prêt, tout de même, à en recommencer un autre.
Faut-il une fin ?
Virginie, pour elle, ce n’est pas un aboutissement, mais une continuité. Un aboutissement impliquerait une fin, ce qui n’est pas le cas. La fin, c’était juste celle du Great Himal Race. Moi, je veux revenir dans ce pays. Le Népal a été une seconde naissance. Là-bas, il y a une part de mon âme. Je le sais. Je dis souvent que j’y retourne parce que je ne l’ai pas retrouvé. J’avoue que je ne cherche plus. Des gens m’ont dit que pour eux, le GHR était un prétexte pour voyager, découvrir le pays ce qui, hors course encadrée, est sans doute difficile… Moi, j’irai là-bas avec mes deux filles avant 2020. Car ce n’est jamais terminé, non. Il n’y a pas de fin.

C’est l’histoire de Bernard Moitessier, le navigateur, qui poursuit la course, qui a besoin de continuer le chemin.
Complètement. Le déplacement n’a pas vraiment de limite, car il n’a pas de finalité. Le voyage, lui, est un passage dans quelque chose. C’est de Cyrille Lambert, un coureur de la Mandala 2012.
Vous avez aperçu Thomas Pesquet dans la Station Spatiale Internationale ?
(Rires) Oui, au moment du départ, notamment ! On voyait très bien l’ISS. Là-bas, il faut chercher le ciel à travers les étoiles. Dans l’Himalaya, à plus de 5000 m, c’est d’une incroyable pureté. Il y a plus d’étoiles que de ciel. Ce n’est pas la voie qui est lactée, c’est la voute céleste. « Je cours, c’est ce qui me rend différent », a dit Hugh McPhail. Courir où il y a plus d’étoiles que de ciel, avec le firmament comme ligne d’horizon, c’est unique et singulier. L’illumination est là aussi. Dans cette différence du déplacement en montagne. Et tu vois ce truc dans le ciel qui va très vite, qui fait seize fois le tour la Terre en 24 heures… L’ISS. J’ai vérifié en rentrant. La station passait bien au-dessus de nos têtes. Elle faisait l’Afrique, remontait la Mer Rouge, le Tibet et passait en bout de l’Himalaya. C’était un clin d’œil à la particule du « Great », comme le résume Damien : « La course que l’on peut voir de la Lune ». Nous devons cette définition à Wouter, le « coureur différent » par excellence.

Les Népalais dont vous parliez, fiers d’avoir redécouvert leur pays, ont vu quoi évoluer ces dernières années ?
Ils ont découvert des endroits qu’ils ne connaissaient pas, des dialectes qu’ils ne maîtrisaient pas. Même Jagan (Timilsina, le vainqueur du GHR) qui est pourtant un guide et alpiniste népalais Mais ils arrivaient toujours à communiquer par des gestes ou avec des dessins. Avec Paul-Eric, en 1994, on avait une petite mappemonde avec nous. On montrait. On était comme des messagers. On discutait autour du feu avec les habitants, le soir, on leur disait que tel ou tel chemin était bloqué par un effondrement de pierres. C’est très intéressant. On n’avait pas de tente. On dormait à la belle étoile ou dans une vieille cabane de berger. Les gens nous invitaient. Certains enfants n’avaient jamais vu un homme blanc. En plus, on avait des pantalons noirs, des t-shirts jaunes et nos cheveux longs, on arrivait en courant… Ils fuyaient en nous voyant ! On avait même décidé de ne plus courir en arrivant dans les villages pour ne pas effrayer les enfants. On avait à peine à manger, pour deux jours maximum. On avait juste un pot de miel avec nous. Un doigt le matin, un le midi, un le soir. On n’était pas encore à l’ère de la communication.
Il y a une nostalgie chez vous, de ce premier long voyage en 1994.
Complètement, oui. Mon rêve, c’est de repartir avec Paul (Bruno a les larmes aux yeux). Même un jour et une nuit, juste avec un sac à dos. Juste le voir courir sur les pierres, revoir son pied disparaître avant que la pierre ne tombe, c’est un truc incroyable chez lui… Il ne tombe jamais, la pierre roule qu’il est déjà parti… (Silence)… Lui aussi est nostalgique. Ça nous rattrapera un jour. Ça vous rattrape toujours.
Rentrer vous est insupportable ?
Je suis revenu. Mais pas complètement. Le premier mois a été terrible. Je suis reporter sportif à Ouest-France. J’oubliais de faire des titres à mes articles, j’oubliais de les corriger. Ou alors je venais travailler alors que je ne travaillais pas. C’est très difficile… Autant là-bas j’étais zen, autant je suis revenu passablement perturbé. Le corps, mais aussi le psychisme. Je montais dans les tours immédiatement, de façon radicale. Ce comportement, ce n’est pas moi, pourtant.
Vous êtes revenu les valises chargées d’émotions.
Je disais tout à l’heure qu’une partie de mon âme était là-bas. En rentrant, je croyais l’avoir perdue. J’étais aussi agacé parce qu’il y avait sur ce Great Himal Race des gens que j’admire et qui ont craqué. Qui ont pris le bus ou un 4×4. Pour l’un deux, Damien, j’étais là. Et je continue à me reprocher de ne pas avoir insisté ce jour-là : « Reste, reste, ça ira mieux demain ». Voir que certains n’ont pas fait la traversée totale, de ne pas avoir pu les aider tous, me mettait en colère. Je suis rentré avec la réussite de onze personnes, mais aussi avec l’échec de tous les autres qui me sont chers. Et je me sens responsable de ça. Coupable. J’aurais pu leur rendre la chose moins dure. J’aurais dû lâcher du lest, accepter qu’on fasse tout ça en 50 jours. Mais non, j’ai voulu qu’on termine en 45 ou 46 jours. C’est con. Là, je travaille sur l’édition 2020, je vais y inclure des jours de repos. Ça coûtera du temps, mais tant pis. Parce que ces mecs-là, ces femmes-là, s’entraînent pendant trois ans pour faire ça, font des emprunts. Ils emmènent des employeurs avec eux, des femmes, des enfants, des amis, pleins de gens. Je pense notamment à François (Navarette). Et ils ont fait la traversée, mais il manque quelque chose quand on prend le bus… Un jour de course. Ça, c’est insupportable. Et je suis responsable.
Vous ne vous dîtes pas, aussi, que vous les avez mis sur un grand chemin ?
Oui, mais ces gens m’ont tellement apporté et ont tellement aidé les autres. Damien et François, c’était des Saint-Bernard de la course. Ce n’est pas un hasard s’ils ont remporté le Prix de Sportivité. Tout ça est évacué, maintenant. Sauf quand je les revois. J’aurais préféré que ce soit moi qui prenne le bus.
Transamericana avec Rickey Gates